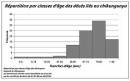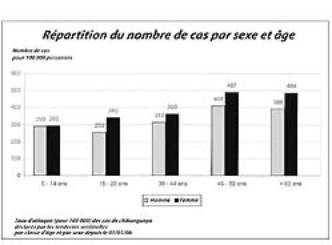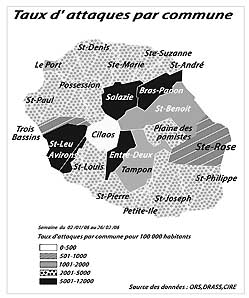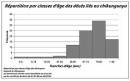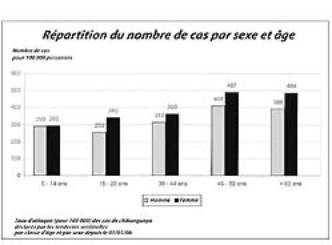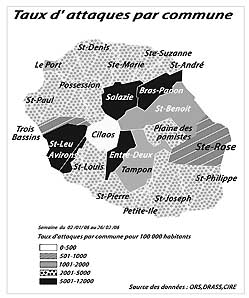
SANTÉ
Explosion du nombre de décès directement liés au
chikungunya
La Drass a rendu publique, hier, le dernier point sur la situation épidémiologique.
Chiffres que nous avions déjà révélés le matin même dans le
“Journal de l’île”. Au 26 février, la Cire fait état de 186 000
personnes contaminées et de 93 décès liés (pour 53) directement ou
(pour 40) indirectement au chikungunya. Par rapport à la semaine précédemment
étudiée, il y a 5 fois plus de personnes mortes directement du virus.
Des données minimales, à prendre avec des pincettes, puisque toutes
les personnes infectées par le virus durant la semaine d’étude
n’ont pas encore été recensées. Alors que le nombre de cas estimés
est en diminution ces dernières semaines, les autorités sanitaires
restent prudentes avant d’annoncer que le pic de l’épidémie a été
atteint. Les services des urgences enregistrent en effet une hausse
inquiétante du nombre de passage pour chikungunya. Si les femmes sont
dans l’ensemble plus touchées que les hommes,
on retiendra que l’épidémie est particulièrement intense dans
l’est (Bras-Panon, Salazie) et le sud-ouest (Saint-Leu, Les Avirons et
l’Entre-Deux).
[4 mars 2006]
Évolution des symptômes
 La
nature des principaux symptômes et leur répartition sont stables
depuis le début de l’épidémie (fièvre et arthralgies :100% des cas ;
céphalées : 70 % ; myalgies : 60% et éruptions :
33 %). Cependant, la fréquence de survenue des myalgies (douleurs
musculaires) semble en légère augmentation.
La
nature des principaux symptômes et leur répartition sont stables
depuis le début de l’épidémie (fièvre et arthralgies :100% des cas ;
céphalées : 70 % ; myalgies : 60% et éruptions :
33 %). Cependant, la fréquence de survenue des myalgies (douleurs
musculaires) semble en légère augmentation.
 Concernant
les formes dites “graves” associées au chikungunya, les signes
cliniques prédominants sont les méningo-encéphalites (10), les autres
atteintes neurologiques centrales (10), les hépatites aiguës sévères
(5), les atteintes cutanées sévères (4), autres (15). Ces chiffres se
réfèrent uniquement au cas biologiquement confirmés chez les patients
âgés de plus de 28 jours admis en réanimation. Au total, 49 cas
d’infection suspectée ou confirmée à chikungunya chez les nouveau-nés
âgés de moins de 28 jours ont été signalés. Parmi ceux-ci, 40 cas
étaient des infections materno-néonatales (survenue entre 0 et 9 jours
après la naissance) dont 33 sont biologiquement confirmées.
Concernant
les formes dites “graves” associées au chikungunya, les signes
cliniques prédominants sont les méningo-encéphalites (10), les autres
atteintes neurologiques centrales (10), les hépatites aiguës sévères
(5), les atteintes cutanées sévères (4), autres (15). Ces chiffres se
réfèrent uniquement au cas biologiquement confirmés chez les patients
âgés de plus de 28 jours admis en réanimation. Au total, 49 cas
d’infection suspectée ou confirmée à chikungunya chez les nouveau-nés
âgés de moins de 28 jours ont été signalés. Parmi ceux-ci, 40 cas
étaient des infections materno-néonatales (survenue entre 0 et 9 jours
après la naissance) dont 33 sont biologiquement confirmées.
 En
ce qui concerne les formes graves (biologiquement confirmés)
d’infections materno-néonatales associées au chikungunya, le
principal syndrome clinique observé est la méningo-encéphalite (10).
Viennent ensuite les atteintes cutanées sévères (7), les syndromes
algiques et troubles de l’alimentation (11), la septicémie (1), les
troubles du rythme cardiaque (2) et la thrombopénie isolée (diminution
du nombre de plaquettes sanguine) (2).
En
ce qui concerne les formes graves (biologiquement confirmés)
d’infections materno-néonatales associées au chikungunya, le
principal syndrome clinique observé est la méningo-encéphalite (10).
Viennent ensuite les atteintes cutanées sévères (7), les syndromes
algiques et troubles de l’alimentation (11), la septicémie (1), les
troubles du rythme cardiaque (2) et la thrombopénie isolée (diminution
du nombre de plaquettes sanguine) (2).

Prudence sur le pic
“La baisse
observée depuis la semaine 5 (du 30 janvier au 5 février, ndlr) est à
interpréter avec énormément de prudence. On ne peut vraiment pas dire
que le pic est passé”, estime Jet de Valk, épidémiologiste à l’InVs.
Si la courbe épidémique, établie sur la base des données du réseau
sentinelle, montre une diminution du nombre de cas estimés entre la
semaine 5 et la semaine 6 (entre le 31/01/06 et le 12/02/06), cette
tendance ne pourra toutefois être confirmée qu’après consolidation
des données des deux dernières semaines étudiées. Et même si
plusieurs indicateurs sont à la baisse (nombre de cas signalés par les
médecins de l’île ou arrêts de travail), il est difficile de se
prononcer sur l’atteinte d’un éventuel pic avant 4 semaines consécutives
de chute. Les autorités sanitaires sont d’autant plus prudentes sur
l’interprétation d’une tendance que le nombre de passages dans les
services d’urgence de tous les hôpitaux de l’île, observés la
semaine 8 (du 20/02/06 au 26/02/06), a augmenté.

La BBC enquête à la Réunion
En même temps
que le Premier ministre, les journalistes parisiens ont pris leurs
jambes à leur cou en début de cette semaine. Après avoir fait leur
B.A. de gratter sur notre maladie tropicale pendant une semaine, au
contact des autochtones, les plumitifs s’en sont allés. Seul un envoyé
spécial de Radio France se risque à rester dans notre zone infestée.
Les journalistes étrangers semblent plus courageux (ou en retard ?).
On compte en effet sur nos terres une équipe de la BBC venue enquêter
sur le CHIK, une journaliste belge de “Le Soir” et un reporter
Suisse.
Le nombre de morts directes explose
93. C’est le
nombre de personnes qui sont mortes directement ou indirectement du
chikungunya au 26 février. Un chiffre qui risque d’être revu à la
hausse prochainement, en raison du décalage des remontées
d’information. Sur ces 93 certificats de décès, on en compte 53 dans
lesquels le chikungunya est mentionné comme cause initiale ou immédiate
du décès, et 40 où il est fait état d’une co morbidité (cause
associée). Le dernier point épidémiologique du 23 février rapportait
77 décès liés au virus, dont 10 pour lesquels aucune autre cause médicale
que le chikungunya n’avait été retenue. Des décès directs dont le
nombre avait alors doublé depuis le précédent point en date du 12 février.
Cette fois, le chiffre est plus de 5 fois supérieur au dernier point épidémique.
On passe en effet de 10 à 53 morts directes. Les décès sont survenus
principalement dans les secteurs Est (35 victimes) et Sud de l’île
(41). Au Nord, on enregistre 7 décès pour 10 sur la même période
(depuis le 1er janvier 2006) dans l’Ouest.

Les femmes plus touchées que les hommes
 Depuis
le début janvier, les classes d’âge sont plus uniformément touchées
qu’au cours des mois précédents.
Depuis
le début janvier, les classes d’âge sont plus uniformément touchées
qu’au cours des mois précédents.
 A
part chez les jeunes (entre 0 et 14 ans), où la différence n’est pas
significative, on observe que le chikungunya atteint plus fréquemment
les femmes que les hommes. L’exemple
le plus flagrant se situe dans la tranche d’âge supérieure à 60 ans :
5 femmes sont touchées pour 4 hommes. Le sang des femmes serait-il
meilleur que celui des hommes au goût des aedes albopictus ? Pas
vraiment. Si à ce jour l’on ne dispose d’aucune explication
scientifique sur le sujet, les spécialistes pensent que c’est
certainement lié au fait que les femmes sont plus découvertes (au sens
vestimentaire) et que le moustique a tendance à vivre autour des
domiciles, sachant que les femmes sont plus présentes à la maison que
les hommes. C’est là qu’on mesure l’intérêt du combat des
femmes pour une égalité d’accès au travail...
A
part chez les jeunes (entre 0 et 14 ans), où la différence n’est pas
significative, on observe que le chikungunya atteint plus fréquemment
les femmes que les hommes. L’exemple
le plus flagrant se situe dans la tranche d’âge supérieure à 60 ans :
5 femmes sont touchées pour 4 hommes. Le sang des femmes serait-il
meilleur que celui des hommes au goût des aedes albopictus ? Pas
vraiment. Si à ce jour l’on ne dispose d’aucune explication
scientifique sur le sujet, les spécialistes pensent que c’est
certainement lié au fait que les femmes sont plus découvertes (au sens
vestimentaire) et que le moustique a tendance à vivre autour des
domiciles, sachant que les femmes sont plus présentes à la maison que
les hommes. C’est là qu’on mesure l’intérêt du combat des
femmes pour une égalité d’accès au travail...
Textes :
Marie Payrard